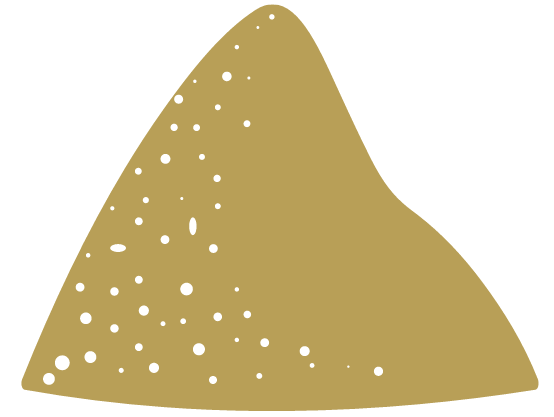Aux origines du Jeu de Sable
Le Jeu de sable trouve ses origines dans les travaux de la pédiatre britannique Margaret Lowenfeld qui, dès le milieu des années 1920, développe une approche thérapeutique innovante à destination des enfants et des adolescents : le Jeu du monde (World Technique).
À la fin des années 1950, la thérapeute suisse Dora Kalff approfondit et transforme la méthode de sa prédécesseure en l’enrichissant des concepts fondamentaux de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, ainsi que de ses connaissances des philosophies et pratiques méditatives orientales. Elle donne alors naissance à une approche spécifique qu’elle nomme : Thérapie par le Jeu de sable (Sandplay Therapy).
Des plateaux de jeux au Jeu du monde
En 1928, Margaret Lowenfeld fonde sa propre clinique dans le nord-ouest de Londres, la Clinic for Nervous and Difficult Children. Frustrée par les limites de la thérapie verbale, dominante dans les milieux psychanalytiques de l’époque, elle cherche une approche différente pour accompagner les enfants. En opposition aux conceptions du jeu défendues alors par Mélanie Klein et Anna Freud, elle développe sa propre méthode thérapeutique. Pour cela, elle s’inspire des dispositifs ludiques imaginés par l’écrivain et penseur britannique Herbert George Wells.

Margaret Lowenfeld en séance dans sa clinique à Londres
ⓒ Dr Margaret Lowenfeld Trust

La Bataille de Hook’s Farm
Petites guerres et Jeux de parquet
Herbert George Wells
ⓒ Bragelonne
Herbert George Wells, inspiré par ses deux fils, présente dans son livre Floor Games, publié en 1911, des principes de jeu simples : offrir aux enfants une grande variété de jouets miniatures et des plateaux en bois de différentes tailles, pour leur permettre de laisser libre cours à leur imagination, de construire leurs propres mondes — plus ou moins civilisés — et d’explorer l’univers créé par leur compagnon de jeu.
Margaret Lowenfeld s’est d’abord inspirée de ce dispositif, avant d’avoir l’idée de remplacer les plateaux en bois par un bac rempli de sable. Avec modestie, elle reconnaîtra que c’est grâce aux enfants qu’elle a accueillis en thérapie que sa méthode a pris forme, et non l’inverse. C’est ainsi qu’est né le « Jeu du monde », également appelé de manière plus familière « Magic Box », un surnom donné spontanément par ses jeunes patients à cette technique.
L'Europe à l'heure du test
À partir du début des années 1930, le Jeu du monde suscite l’intérêt de nombreuses figures majeures de la psychologie à travers toute l’Europe. Charlotte Bühler, psychologue d’origine allemande, fait partie des premières à étudier de près les travaux de Margaret Lowenfeld. Elle mènera ensuite ses propres recherches, qui aboutiront en 1950 à la création d’un outil de diagnostic des troubles psychologiques : le test du Monde (World test).
En 1939, lors d’un voyage professionnel en Hollande, le psychologue français Henri Arthus découvre ce test. Impressionné par cette méthode, il décide de la rapporter à Paris pour poursuivre ses propres investigations. Progressivement, il développe une nouvelle version du test, en réduisant la diversité des objets utilisés à ceux appartenant à l’univers des villes, puis des villages. Il baptise cette adaptation le test du Village.

Le test du Village imaginaire
Roger Mucchielli
ⓒ EAP
En 1945, Pierre Mabille, médecin français, reprend le test du Village et fait progresser de manière significative les travaux de son prédécesseur. En 1950, il propose une nouvelle standardisation du test, visant à diagnostiquer les structures de personnalité.
En 1960, Roger Mucchielli, neuropsychiatre, psychologue et philosophe français, approfondit les recherches de Pierre Mabille et crée sa propre version : le test du Village imaginaire. Son test projectif suscite alors l’intérêt des professionnels en psychiatrie infanto-juvénile et se diffuse à travers toute la France. Aujourd’hui, la passation du test du Village imaginaire a diminué, car la production et la distribution du matériel ont cessé, en raison de coûts trop élevés. Cependant, l’Association pour la Recherche en Psychothérapie Existentielle par le Jeu (A.R.P.E.J.), basée à Rennes, compte parmi ses membres de nombreux psychologues qui continuent à utiliser ce test, que ce soit comme outil diagnostique (Le Village imaginaire, Roger Mucchielli, 1976) ou comme méthode thérapeutique (Le Village itératif, Yvonne Denis, 2015).
De la technique à la thérapie des profondeurs
En 1954, le Jeu du monde attire l’attention de Dora Kalff, thérapeute pour enfants et psychanalyste suisse formée à l’Institut Carl Gustav Jung de Zurich. Convaincue du fort potentiel thérapeutique de ce dispositif unique, elle se rend l’année suivante à Londres pour se former auprès de Margaret Lowenfeld. À la fin des années 1950, elle approfondit et transforme la méthode de sa prédécesseure en l’enrichissant des concepts fondamentaux de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, ainsi que de ses connaissances des philosophies et pratiques méditatives orientales. Elle donne alors naissance à une approche spécifique qu’elle nomme : Thérapie par le Jeu de sable (Sandplay Therapy).
Cette approche met l’accent sur les bienfaits de « l’espace libre et protégé » offert par le bac à sable, ainsi que sur l’environnement thérapeutique instauré par la présence silencieuse, attentive et engagée du thérapeute. Ce dernier accueille son patient sans jugement ni interprétation immédiate, concentrant son attention sur les créations de sable au fil de la cure pour en comprendre les enjeux inconscients. L’interprétation des jeux est réservée à la fin de la thérapie, où sont analysés aussi bien la succession des jeux réalisés tout au long du processus que chaque création prise isolément.

Dora Kalff en séance dans son cabinet à Zollinkon en Suisse
ⓒ Peter Ammann
Des « jeux » de sable
Lorsque le Jeu du monde et la Thérapie par le Jeu de sable ont traversé l’Atlantique au cours de la seconde moitié du XXᵉ siècle, ils ont rencontré le courant des thérapies humanistes déjà bien établi en Amérique du Nord. C’est au début des années 1990 que le travail thérapeutique utilisant des objets miniatures et un bac à sable a vraiment pris son essor, notamment grâce à Gisela Schubach de Domenico, docteure en psychologie originaire de Californie. Elle a contribué à élargir cette approche aux couples, familles et groupes. Après plusieurs années de pratique et de recherche, elle a développé une méthode proche qu’elle a nommée « Bac à sable-Jeu du monde » (Sandtray-Worldplay).
Aujourd’hui, l’approche intégrative du travail thérapeutique avec des figurines et un bac à sable, héritée de Margaret Lowenfeld, est connue sous l'intitulé « Thérapie par le Bac à sable » (Sandtray Therapy). Cette méthode est principalement soutenue par des thérapeutes humanistes et intégratifs tels que Linda Homeyer, Daniel Sweeney, Stephen A. Armstrong et Amy Flaherty. La Thérapie par le Bac à sable est surtout développée en Amérique du Nord et dans le monde anglo-saxon, où elle est promue par des organisations comme l’International Association for Sandtray Therapy, la World Association of Sand Therapy Professionals, et la Play Therapy International.
Bien que le Jeu du monde de Margaret Lowenfeld ait inspiré de nombreux thérapeutes en Europe dès les années 1950, c’est surtout l’approche jungienne du Jeu de sable, développée par Dora Kalff, qui est aujourd’hui la plus répandue à l’échelle mondiale. Cela est dû au travail de transmission réalisé par Dora Kalff et ses successeurs — dont son fils Martin Kalff — à travers l’International Society for Sandplay Therapy, ainsi que par Barbara Turner pour l’Association for Sandplay Therapy.
En France, la Société française du Jeu de sable, créée récemment, a pour mission de promouvoir cette méthode auprès des thérapeutes, des institutions de soin et des usagers. Pour cela, elle référence les formations et les praticiens répondant à ses critères de reconnaissance, organise des colloques, publie une revue, et favorise la création de groupes d’analyse de pratique et de réflexion clinique entre professionnels sur tout le territoire.